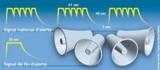La prévention
Une législation dense et spécifique définit le processus réglementaire de création, de construction, de démarrage, de surveillance et de démantèlement des installations nucléaires afin de prévenir les risques d'accidents. Cette politique de prévention s'appuie sur 4 pilliers :
La réduction du risque à la source
-par la mise en place d'un plan d'urgence interne (PUI) par l'exploitant et d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI) établi sous l'autorité du préfet -par une étude d'impact, imposée à l'exploitant afin de réduire au maximum les nuisances causées -par le fonctionnement normale de l'installation -par une étude de dangers, dans laquelle l'exploitant identifie les accidents les plus dangereux pouvant survenir -par la qualité et la formation du personnel. Le décret n°2003-295 du 31 mars 2003 impose la présence d’une ou plusieurs personnes compétentes en radioprotection dans toutes les entreprises utilisant une source de rayonnements ionisants. Le personnel d’une centrale nucléaire bénéficie de formations et d’entraînements spécifiques. Des exercices de simulation d’accidents nucléaires sont régulièrement organisés sur l’ensemble des installations nucléaires en France. Ainsi, le CNPE de St Alban – St Maurice l’Exil dans l’Isère a fait l’objet à ce titre d’un exercice national de crise le 26 octobre 2004. |
La surveillance et le contrôle
|
L'organisation des secours
La protection de la populationEn fonction du niveau de gravité de l'accident, différentes mesures peuvent être ordonnées : La mise à l'abri (confinement) des populations dans les habitations L'évacuation des populations La distribution de pastilles d'iode Dans le cas des réacteurs électronucléaires, l'élément radioactif constituant le principal contaminant des rejets serait de l'iode radioactif (I131). À titre préventif, certains départements ont organisé une distribution de pastilles d'iode non radioactif auprès de la population habitant dans un rayon de cinq kilomètres autour de la centrale. Sur consigne du préfet, diffusée en cas d'accident par la radio, les habitants seraient invités à absorber ces pastilles d'iode. Cet iode stable a pour effet de se fixer sur la thyroïde (organe qui retient l'iode), la saturer et éviter qu'ensuite l'iode radioactif inhalé par respiration, se fixe sur cette thyroïde provoquant son irradiation. Des pastilles d'iode en dépôt dans les pharmacies sont d'autre part à la disposition de la population dans la couronne située autour de vingt kilomètres autour de la centrale. Des pastilles d'iode en dépôt dans les pharmacies sont d'autre part à la disposition de la population dans la couronne située entre cinq et dix kilomètres autour de la centrale. L'organisation des secours
Au niveau départemental, le Plan Particulier d'Intervention (PPI) est mis en place par le préfet pour faire face à un sinistre sortant des limites de l'établissement. La finalité de ce plan départemental de secours est e protéger les populations des effets du sinistre. Par ailleurs, des plans généraux d'organisation des secours (plan ORSEC, plan rouge) existent au niveau du département. Ils seront déclenchés si besoin. Les directeurs d'écoles et les chefs d'établissements scolaires élaborent quant à eux un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) afin d'assurer la sécurité des élèves et du personnel. Au niveau individuel et d'une manière générale, il est conseillé de mettre en place un Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS) pour éviter la panique en cas d'accident. Préparé et testé en famille, il permet de mieux faire face en attendant les secours. Il s'agit de :
|
L'information
L'information des acquéreurs et locataires (IAL). Depuis le 1er juin 2006, chaque nouveau propriétaire ou locataire doit être informé par le vendeur ou le bailleur des risques majeurs auxquels peut être soumis son futur logement. Le dossier départemental sur les risques majeurs ( DDRM), réalisé par le préfet. Il permet de connaître, pour chaque commune du département, la liste des risques majeurs auxquels elle est soumise. A partir de ce DDRM, le maire doit réaliser un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) afin d'informer ses administrés et surtout leur présenter les consignes de sauvegarde à appliquer en cas d'accident majeur. Il est à la disposition des habitants dans leur mairie. Le maire définit les modalités d’affichage du risque nucléaire. L’information du public joue un rôle essentiel pour la connaissance et la perception de l’importance des risques liés à la présence d’une installation nucléaire, ainsi qu’à la conduite à tenir en cas d’accident. Chaque installation nucléaire est soumise à enquête publique dans le cadre notamment de la procédure d’autorisation et de création.
Les populations riveraines doivent recevoir tous les cinq ans une information spécifique financée par les exploitants, sous contrôle du préfet. Cette campagne, généralement appelée campagne PPI, doit notamment porter sur la nature du risque, les moyens de prévention mis en place, ainsi que les consignes à adopter. Des Commissions locales d'information (CLI) sont créées autour de chaque centrale électronucléaire et éventuellement de toute Installation Nucléaire de Base importante (centre de recherche, stockage de déchets, etc.). Composées d'élus, de représentants des organisations syndicales et agricoles, de personnalités qualifiées, de représentants des associations et des médias, elles recueillent et diffusent auprès de la population toutes les informations concernant le fonctionnement, les incidents, l'impact sur l'environnement des rejets de l'installation, etc. Elles se réunissent au moins une fois par an. L’ échelle de gravité internationale (INES) permet de faciliter la perception par le public et les médias de l’importance en matière de sûreté des incidents et accidents nucléaires (que ce soit pour les installations « fixes » ou pour le transport de matières radioactives). Cette échelle à 8 niveaux (de 0 à 7) permet de classifier les incidents et accidents en fonction de leurs conséquences. |